
Numéro : 191
Parution : Octobre / Novembre 2018
- Tarif au numéro - numérique : 6.20€Magazine numérique
- Tarif au numéro - papier : 6.90€Magazine papier
- Accès aux archives Multicoques Mag Les archives
Après l'impressionnante visite de Komodo, et ses célèbres dragons, l'équipage de Jangada continue son aventure autour du monde avec les îles de Sumbawa et Lombok…
Au nord-ouest de Sumbawa, un énorme volcan…
Nous avons délaissé les rivages tumultueux du Selat pour reprendre notre route vers l’ouest, au nord des petites îles de la Sonde, en direction de Sumbawa, Lombok, et Bali. Pour l’heure, nous longeons l’île de Sumbawa, moins connue que Florès ou Lombok. Sumbawa, une île plutôt aride, abrite un monstre, bien connu des volcanologues, un volcan d’une puissance terrifiante, un détenteur de records : le Tambora. Pendant des heures, une petite brise d’est nous pousse le long de l’interminable cône volcanique de ce volcan massif, dont le sommet disparaît dans les nuages. Puisque nous naviguons au pied de ses contreforts, je m’intéresse au Tambora. Voyager, découvrir, s’instruire par ses propres moyens, j’adore. Bien sûr, l’Indonésie abrite quelques dizaines de volcans majestueux, mais ce qui fait l’intérêt du Tambora, c’est qu’il est à l’origine du premier évènement climatologique de portée mondiale de l’ère moderne. Mensurations : 60 km de diamètre à la base, avec au centre du cône volcanique une caldeira de 6 km de diamètre, profonde de 1 100 mètres, dont la formation remonte à l’éruption cataclysmique de 1815. La dernière éruption du Tambora date de 1967 ; depuis, le monstre somnole. Cela vaut mieux pour nous. Nous passons discrètement à sa base. Avant 1815, l’altitude du volcan devait approcher les 4 300 mètres. Du sérieux, lorsque, comme c’est le cas, le volcan plonge directement dans la mer. Il perdit en quelques heures la bagatelle de 1 500 m d’altitude !!! Evidemment, cette décapitation du Tambora ne se fit pas sans quelque bruit, quelques fumées, et quelques dégâts. Après une période de plusieurs mois de signes précurseurs d’une probable éruption, une première explosion intervint le 5 avril 1815, que l’on entendit jusqu’à Batavia (aujourd’hui Jakarta), à près de 1 300 km ! Mais, dans la capitale de la colonie hollandaise, on mit du temps à comprendre l’origine de la détonation. Il fallut attendre que les cendres recouvrent la ville… Le paroxysme de l’éruption eut lieu le 10 avril, avec une colonne éruptive de 45 km de hauteur, des pluies de cendres, et une violente onde de choc qui détruisit le village de Sanggar, 30 km à l’est du cratère. De 11 000 à 12 000 personnes furent tuées directement par l’éruption, mais environ 50 000 autres furent victimes des tsunamis, de la famine et des épidémies qui suivirent, essentiellement sur les îles de Sumbawa et Lombok. Mais l’élément le plus remarquable (et le premier connu du genre) des suites de l’éruption d’avril 1815 fut bien l’étendue planétaire des conséquences climatiques de l’énorme rejet dans l’atmosphère de matières expulsées par le Tambora. Les archives de cette époque ont permis pour la première fois de retracer l’influence globale de l’éruption sur la mécanique atmosphérique mondiale, largement ignorée à l’époque. Loin de l’île de Sumbawa, et plus insidieuse, plus durable aussi, la chaîne des réactions climatiques à l’éruption du puissant volcan tua, principalement dans les 3 années qui suivirent, nombre d’habitants (on parle de 200 000 morts) de la planète, qui ignoraient complètement son existence même. Il fallut attendre beaucoup plus tard pour que les scientifiques prennent l’exacte mesure de l’influence planétaire d’un tel phénomène sur la circulation générale de la haute atmosphère terrestre, une notion inimaginable à l’époque de l’éruption.

et Pulau Medang, une petite île de rêve…
Jangada trace un sillage léger et éphémère au pied du géant, qui finit, au fil des heures, par s’estomper progressivement sur l’arrière. Nous passons à proximité d’une petite île détachée de quelques centaines de mètres du rivage, Satonda. C’est un cratère secondaire du Tambora, situé au niveau de la mer, et aujourd’hui occupé par un lac d’eau douce. Nous passons au nord de Moyo, et retrouvons le large. Une petite île, quasiment sur notre route vers Lombok, a retenu mon attention sur la carte : Pulau Medang. Isolée, je la devine authentique, habitée de pêcheurs et de cultivateurs. Elle nous tend les bras, avec une baie accessible sur sa côte nord, abritée des vents dominants d’est en cette saison. Nous décidons d’y faire escale. Va pour Pulau Medang !
Nous y resterons 3 jours, découvrirons un village charmant tout en longueur que je ne me lasserai pas de parcourir, mon appareil photo à la main. Marin et moi serons invités à partager le repas de villageois occupés à construire une maison familiale.
C’est là aussi que, tout en achetant quelques noix de coco à boire à la petite vendeuse ambulante du village, nous ferons auprès d’elle, à sa grande surprise, l’acquisition de sa machette, avec son étui de bois ! Après nous être assurés, tout de même, qu’elle était en mesure de la remplacer ! Un bel outil patiné par l’usage et le temps, et dont rêvaient depuis longtemps les enfants. Les noix de coco des atolls de l’océan Indien n’ont qu’à bien se tenir…

Lombok, un avant-goût de Bali…
Lombok, c’est l’antichambre de Bali. Version musulmane modérée, un détail qui change l’ambiance générale pour le visiteur. Belles plages de sable blanc, jolis spots de surf, incroyables sites de plongée sous-marine. Un volcan, le Gunung Rinjani, se perd dans les nuages à près de 4 000 mètres d’altitude. Ce relief élevé a l’avantage d’attirer la pluie, et d’irriguer les rizières et les cultures telles que le tabac, le café, et la noix de cajou. Nous savions qu’à Lombok, il nous faudrait renouer avec la civilisation, et le tourisme. Nous allions quitter l’Indonésie profonde, un visage de ce pays que nous avions aimé. Lombok, dans notre esprit, était un sas avant Bali.
Gili Air, drôle de nom pour une petite île ! Les îles Gili (prononcer guili) s’accrochent aux récifs coralliens au nord-ouest de Lombok, la dernière île avant Bali. Au nombre de trois (Gili Air, Gili Meno et Gili Trawangan), ces minuscules îlots de quelques kilomètres de circonférence sont épargnées par les voitures et les pétrolettes. Mais elles sont envahies de touristes ! On y circule à pied, en vélo, ou en calèche. Palmiers et plages de sable blanc, avec paillotes locales. Version grand confort. Accessibles en quelques minutes depuis Lombok, elles le sont aussi de plus en plus depuis Bali, par des speed boats qui traversent le détroit, chargés de touristes pressés. Très prisées des Occidentaux, elles regorgent de pensions, guest houses et petits hôtels plutôt charmants, il est vrai, et plus encore d’innombrables bars, warongs, et restaurants de tous standings. Gili Air, la plus proche de Lombok, est un bon compromis. Gili Meno est la plus calme, la moins équipée, la moins fréquentée. Quant à Gili Trawangan, c’est la plus branchée, la plus festive, la plus équipée en bars de plage. Spot mondialement connu de plongée sous-marine. En arrivant du petit village de Pulau Medang, isolé et paisible, le choc des Gili est rude pour l’équipage de Jangada. C’est le retour brutal à la civilisation des loisirs, et à celle de la consommation, version visages pâles.

Nous longeons le récif corallien, poussés par un fort courant qui nous emmène dans le détroit qui sépare Lombok de Bali, le Selat Lombok. Nous faisons le tour de Gili Air, et cherchons un mouillage, mais les abords des îles Gili en sont peu pourvus. Finalement, nous mouillons sur le tombant, mais cet ancrage précaire se révélera vite intenable au plus fort du courant de marée. Nous irons au sud de l’île, prendre un coffre dans la zone de trafic des embarcations qui relient Gili Air à Bangsal, le village qui dessert les îles juste en face, sur Lombok, à moins de 2 milles de là. Bruyant et chahuté, mais nous n’avons guère d’autre choix. Nous allons à terre, pour retrouver, avec une certaine appréhension, la civilisation occidentale et ses codes. Une petite piste sablonneuse fait le tour de Gili Air, dont le rivage est flanqué, à l’est et au sud principalement, d’une multitude de petits établissements hôteliers et de restauration, plutôt sympathiques et agréables à l’œil. Les grands fauteuils en bambou y sont légion, et il est de bon ton de prendre son petit déjeuner allongé sur un tatami, installé à quelques mètres à peine de l’eau cristalline. Nous faisons le tour de l’île, à pied, parfois doublés par l’une de ces petites carrioles ombragées tirée par un courageux petit cheval, sec, rapide, et rude à la tâche. Le soleil est haut dans le ciel, et cet effort nous a donné faim et soif. Les enfants en rêvent, nous allons donc déjeuner dans un warong au bord de l’eau, d’un gado-gado ou d’un nasi goreng, inévitablement arrosé pour les enfants d’un Sprite ou d’un Coca, et, pour nous, d’une Bintang bien fraîche… Nous repérons quelques bars avec wifi, mais ce qui frappe le plus aux îles Gili, c’est bien le nombre incroyable de clubs de plongée par kilomètre de rivage. Une bonne douzaine sur Gili Air, et plus d’une trentaine sur Gili Trawangan. Une véritable industrie…

Nous inscrivons Marin à une sortie plongée sur épave. Il a de la chance, il sera drivé par un instructeur français très sympathique, Paul, avec qui nous irons déjeuner le lendemain dans une gargote indonésienne du centre de l’île, et qui, le soir même, vivement intéressé par notre voyage en voilier, tiendra à me poser mille questions sur ce type d’aventure. Je crois l’avoir persuadé qu’avec ses brevets de plongeur sous-marin (l’un des meilleurs jobs possibles pour faire rentrer du cash dans la caisse de bord lorsqu’on effectue un voyage en voilier), il trouverait de quoi vivre à peu près partout autour du monde, et qu’il lui restait juste à apprendre à naviguer un minimum à la voile. Marin reviendra ravi de sa sortie dans les coraux de Gili Trawangan. Adélie, de son côté, est ravie d’avoir rencontré Sapke, une jeune fille belge de son âge, qui navigue en famille avec ses deux petits frères et ses parents sur un monocoque de 46 pieds, joliment appelé A Small Nest, un petit nid. Nous serons amenés à nous revoir par la suite, car A Small Nest fait route comme nous vers l’Afrique du Sud pour rentrer ensuite au pays. En gros, même itinéraire et même timing, deux familles avec enfants, une rencontre appréciable.

Nous rejoignons le mouillage de Bangsal, au nord-ouest de Lombok, qui nous permettra d’effectuer une excursion d’une journée à l’intérieur de l’île. Le lendemain, nous montons tous dans un minibus Toyota, et partons vers le centre et le sud de Lombok. Bon, soyons franc, ce style d’excursion n’a pas ma préférence, tant s’en faut, mais Marin et Adélie semblent tellement heureux de passer la journée avec d’autres enfants ! Les rizières succèdent aux villages, des bandes de singes jonchent le bord des routes sinueuses qui grimpent dans la montagne. Notre guide organisateur Mohammed semble avoir du mal à comprendre que je n’apprécie guère d’avoir à balancer, sur sa proposition insistante, des cacahuètes (qu’il a achetées pour nous auparavant en faisant stopper le minibus dans un village, tout en nous précisant que l’achat desdites cacahuètes était inclus dans le tarif) aux guenons habituées au manège et qui ont immédiatement rappliqué sur l’aire de stationnement lorsque le Toyota s’y est arrêté pour cette séquence hautement authentique de la vie sauvage locale… Je renonce à tenter de lui expliquer ma position sur l’alimentation des animaux non domestiques dans leur milieu naturel. Mais je le vois déçu, perturbé. Je ne suis pas un bon touriste, bien docile, voilà ce que Mohammed doit penser. Je ne lui en veux pas, d’autant que c’est, pour lui et notre chauffeur, le premier jour du ramadan musulman…
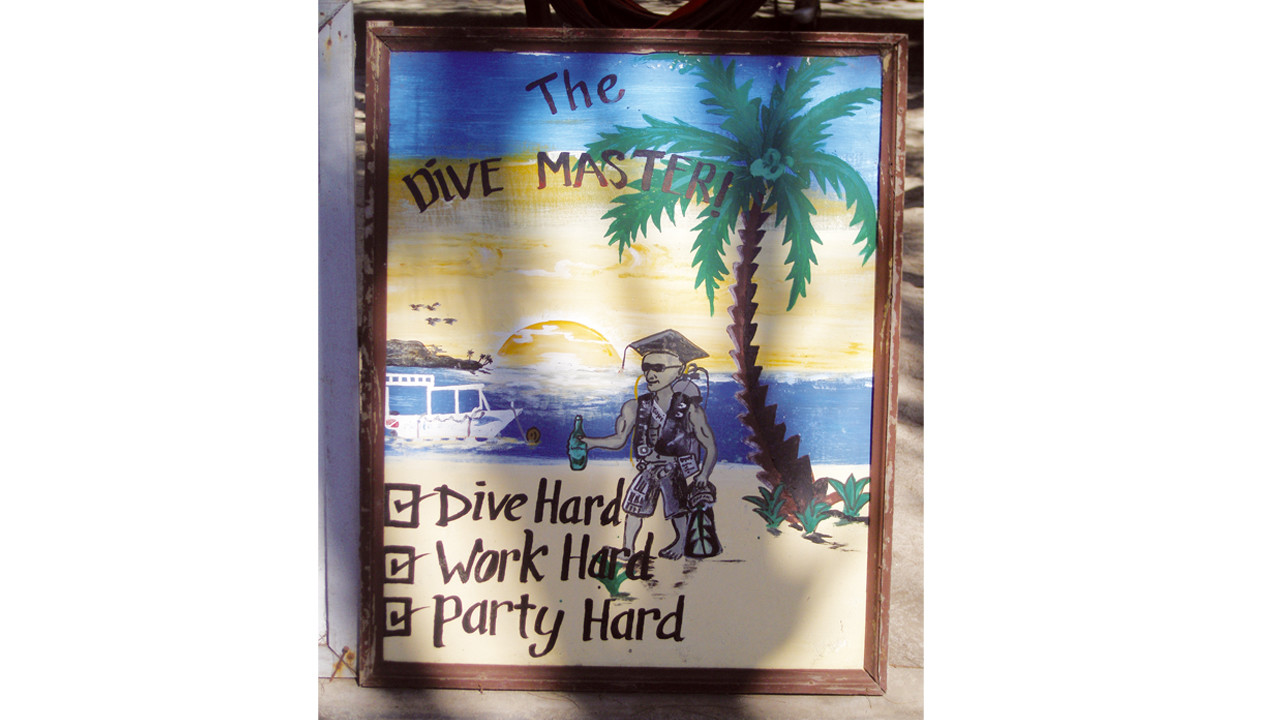
Nous visiterons un atelier de poterie, un autre de batik, un village de tisserands, et pousserons jusqu’à la plage de Kuta, dans le sud, un spot de surf réputé. Alors qu’il fait un soleil radieux, Marin aura besoin d’un ikat pour se réchauffer pendant que nous déjeunons dans un warong du bord de plage. Nous nous inquiétons d’une possible crise de paludisme, ce serait vraiment moche, mais c’est plus vraisemblablement une crise de dengue qui l’atteint. Courbatures, frissons, fièvre. Le lieutenant du bord se chargera de la médication, le capitaine, du moral de l’équipage, et notre ado retrouvera une bonne forme en quelques jours. J’aurais aimé visiter les ateliers de fabrication de mobilier en bambou, de très belle facture, mais Mohammed semble penser que ça ne présente aucun intérêt pour les touristes, alors on s’en passera. Le Toyota rentrera à l’heure, au coucher du soleil, les singes ont mangé leur ration de cacahuètes, et, pour ce premier jour de ramadan (le plus difficile pour l’estomac, paraît-il), je tendrai régulièrement la bouteille de soda frais à notre chauffeur, dès qu’une ligne droite sera en vue, pour l’aider à finir sa journée sans crise d’hypoglycémie, mais pas avant que le signal de la fin du jeûne soit donné sur l’autoradio du véhicule par l’émetteur FM local. Le ramadan, c’est comme le reste, ça se modernise.

Merci Alfred…
Mais savez-vous que l’île de Lombok présente une particularité intéressante ?
Elle est traversée par une curieuse ligne, non matérialisée, mais bien réelle. On l’appelle la ligne Wallace. Alfred de son prénom, Russel Wallace de son nom, était un savant britannique, qui, dans la mouvance des idées de l’époque, entre autres celles de Darwin, réfléchissait à la théorie de l’évolution des espèces, par la sélection naturelle. Naturaliste, botaniste et ornithologue émérite, Wallace passa huit années de sa vie en Malaisie et en Indonésie, à étudier plus particulièrement la faune, principalement les oiseaux et les insectes. Sa théorie la plus intéressante, il la développa lors d’un séjour dans l’archipel des Moluques, au cours des périodes de lucidité que lui octroyaient les fièvres paludéennes qu’il avait contractées. Convaincu du bien-fondé du principe de l’adaptation des êtres vivants à leur milieu naturel, il réfléchit au mécanisme de l’évolution des espèces, et développe le concept de survie du plus apte, selon lequel, en gros, les organismes biologiques les mieux adaptés aux modifications de leur environnement ont de plus grandes chances de survie lorsque celles-ci surviennent. Dès lors, ce sont ces organismes qui se reproduiront, en transmettant leurs caractères génétiques, progressivement modifiés, à leur descendance. Les autres sont condamnés à disparaître. C’est la sélection naturelle. Une notion difficile à accepter pour les humains. Après avoir arpenté pendant des années le Sud-Est asiatique, Wallace relève une discontinuité biogéographique marquée entre deux grandes zones écologiques, couramment définies comme "indomalaise" et "australasienne". Il trace une ligne, appelée quelques années plus tard ligne Wallace, qui passe entre Lombok et Bali, entre Bornéo (Kalimantan aujourd’hui) et les Célèbes (Sulawesi aujourd’hui). Les nombreuses observations faites par Wallace sur le terrain l’avaient conduit à noter des différences frappantes dans la composition de la faune entre l’île de Bornéo et l’archipel des Célèbes, distantes de seulement quelques dizaines de kilomètres. Cette discontinuité était encore plus remarquable entre les îles de Bali et Lombok, seulement séparées par un détroit d’une vingtaine de kilomètres. A Bali, Wallace avait observé nombre d’espèces d’oiseaux également répandues sur le continent asiatique et dans les îles indonésiennes de l’ouest, tandis qu’à Lombok, il avait noté la présence d’oiseaux typiques de la zone australasienne, comme les cacatoès, les casoars, les paradisiers ou les mégapodes, que l’on trouve aussi plus à l’est, à Florès et à Timor. En bon naturaliste, Wallace avait fait le même genre d’observations pour les mammifères. La ligne Wallace mettait ainsi les Philippines, Bornéo et les îles de Bali, Java et Sumatra dans la zone indomalaise, tandis qu’elle rangeait dans la zone australasienne la Nouvelle-Guinée, les Moluques, les Célèbes, et toutes les petites îles de la Sonde à l’est de Lombok (comprise), ainsi que Timor. La zone biogéographique australasienne correspond à l’ancien continent, qui se sépara, il y a quelques 100 millions d’années, pour donner naissance à l’Antarctique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie Nouvelle-Guinée, et une partie de l’Amérique du Sud. Ainsi, les observations de Wallace ont mis en évidence que, bien que la distance qui sépare de part et d’autre de sa ligne certaines îles soit de nos jours très faible, une majorité d’espèces animales et végétales présentes de chaque côté de la ligne sont très différenciées. Ce constat accrédite bien sûr le fait qu’elles furent, ces espèces, notoirement séparées pendant très longtemps, et que seule la dérive ultérieure des continents les a par la suite rapprochées, mais somme toute depuis un laps de temps trop court sur le plan biologique pour que les échanges génétiques effacent l’évolution propre que chaque espèce avait vécue de part et d’autre… Incroyable, cette histoire ! Bref, l’Océanie se termine à Lombok, tandis que l’Asie commence à Bali ! Merci Alfred d’avoir autant réfléchi ! Allez, nous, les humains de Jangada, on ne sait pas trop d’où l’on vient, encore moins où l’on va, alors on franchit allègrement la ligne Wallace, direction Lembongan, une petite île qui sert d’antichambre au port de Benoa, à Bali…
Texte et photos : Olivier Mesnier
Les avis des lecteurs
Postez un avis
Il n'y a aucun commentaire.